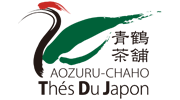Les types de thés
Aborder un univers aussi vaste que celui du thé japonais peut sembler difficile de prime abord, on peut se sentir un peu dépassé par les différents types de thé, les dénominations parfois arbitraires des articles dans certaines boutiques, etc, et ne simplement pas savoir par où commencer. Au travers de ces différentes pages nous allons vous fournir les explications nécessaires pour vous y retrouver, à commencer ici par un guide des différents types de thé japonais (je n’évoquerai ici que les thés issus des feuilles du théier camellia sinensis, pas les autres types d’infusions japonaises comme le mugi-cha ou le soba-cha).
Qu’est-ce que le thé japonais ?
Le thé produit au Japon est pour 99% du thé vert, c’est à dire un thé dont les feuilles ne sont pas oxydées, par opposition aux thés noirs et Oolong dont les feuilles subissent un processus d’oxydation (on parle habituellement de manière fautive de fermentation). Pour stopper les enzymes responsables de l’oxydation des feuilles de thé, celles-ci doivent être chauffée après la récolte. La méthode la plus répandue dans le monde consiste en une sorte de torréfaction, c’est à dire que les feuilles sont chauffées directement sur une surface chaude. Néanmoins, il existe d’autres méthodes, les feuilles peuvent être bouillies (très rare de nos jours), ou bien étuvées (chauffées à la vapeur).
C’est la méthode par étuvage qui est essentiellement utilisée au Japon, puisque la quasi-totalité des thés verts japonais sont étuvés, c’est le cas des sencha, gyokuro, kabuse-cha, tamaryokucha, et même du matcha. Seul le kama-iri cha, très minoritaire, est fabriqué avec un processus de chauffage direct pour stopper l’oxydation.
L’étuvage possède l’avantage d’être en théorie très rapide et efficace, la désactivation des enzymes se faisant à l’instant où l’eau sous forme gazeuse se transforme en eau sous forme liquide en suspension au contact des feuilles, ce changement d’état produisant une quantité de chaleur latente très importante. Ainsi, il est possible de dire que la caractéristique du thé japonais est d’être du thé vert étuvé.
Enfin, si on peut faire remonter l’histoire du thé au Japon au 8ème siècle, le développement du thé tel qu’on le connait aujourd’hui est assez récent, avec d’abord la généralisation à partir du 19ème siècle de la méthode de fabrication du thé dite de Uji, technique particulière de roulage des feuilles étuvées mise au point par Nagatani Sôen en 1738 (il existait déjà auparavant des thés étuvées et roulés selon des méthodes différentes), mais surtout par l’évolution de cette technique, opérée à Shizuoka, au milieu du 19ème siècle, répondant à une demande pour l’exportation vers les USA essentiellement. C’est cette méthode de fabrication manuelle du sencha, qui durant la 2ème moitié du 19ème et la 1ère moitié du 20ème siècle, sera reproduite par des machines avec un succès et une efficacité exceptionnelle. C’est ainsi une autre manière de caractériser le thé du Japon, par le caractère inédit de la mécanisation de la production, dépassant globalement la qualité du travail manuel.
Sencha
Le sencha représentait en 2019 53% de la production de thé brut du Japon. Ce chiffre peut paraître faible et est à relativiser car c’est la proportion sur le total de la production, toutes récoltes confondues, incluant des bancha bas de gamme étant en parti transformés en hojicha ou destiné aux produits en bouteille. Mais regardant seulement les récoltes de printemps (premières récoltes, (jp.) ichibancha) desquelles proviennent le thé de qualité, le sencha représente alors une proportion bien plus importante, les 3/4 environ, et c’est le genre essentiel par où commencer sa découverte, mais aussi, de par sa variété et sa richesse, cela reste aussi genre où vous approfondirez toujours votre connaissance des thés japonais.
Après la cueillette, les feuilles sont d’abord étuvées avant d’être roulées, malaxées et chauffées dans le but de les sécher. Il y a quatre phases principales de malaxage ou roulage, 1. Le malaxage primaire (feuilles roulées et chauffées), 2. Roulage (simple malaxage circulaire, sans chaleur), 3. Malaxage secondaire (feuilles roulées et chauffées), 4. Malaxage final (feuilles roulées et chauffées).
Ensuite les feuilles sont simplement séchées par chaleur pour obtenir un thé brut (que l’on appelle aracha) dans lequel il reste 5% d’humidité. Ce thé brut doit ensuite être trié pour en retirer les tiges, la poudre, calibrer les feuilles de tailles différentes, etc, puis passer par une phase de séchage ou torréfaction finale, appelé hi-ire en japonais, pour descendre le taux d’humidité à 3% environ. C’est alors que le thé devient un produit fini. Cette phase de raffinage est essentielle.
Aujourd’hui on distingue deux grands types de sencha : les « futsûmushi sencha », sencha à l’étuvage standard, et les « fukamushi sencha » sencha à l’étuvage long, d’invention plus récente, dans les années 1950. On trouve parfois les termes de « asamushi » (étuvage léger, terme qui correspond à la même chose que « futsûmushi »), « chûmushi » (étuvage intermédiaire) ou encore « tokumushi » (étuvage spécial), mais en l’absence de standards bien définis, les autorités telles que l’Association Centrale du Thé Japonais ne parlent plus que de « futsûmushi sencha », et de « fukamushi sencha ». S’il existe beaucoup de nuances, on peut dire que le premier donne un thé aux feuilles entières et une infusion claire et limpide, alors que le deuxième a des feuilles plus brisées, et une infusion trouble parfois opaque.
Ombrage ?
En principe, le sencha est considéré comme un thé de plein soleil, c’est à dire dont les plantations ne sont pas sujettes à un ombrage. Pourtant, dans la réalité, une part très importante des sencha est aujourd’hui ombrée plus ou moins longtemps avant la récolte pour répondre à une demande pour des thés avec plus d’umami et une couleur plus verte (nous expliquerons ce phénomène pour le gyokuro).
Enfin, la grande diversité des cultivars (ce que l’on appellerait cépage pour le vin) vient ajouter à la richesse aromatique de cette grande catégorie que représentent les sencha.
Aussi, si le sencha regroupe sous une même dénomination des thés aux arômes parfois radicalement différents, il regroupe aussi une large gamme de thés des plus modestes aux plus haut de gamme.
Gyokuro
Le gyokuro est souvent vu comme le thé japonais de luxe, mais cette vision n’est pas appropriée car d’une part il y a une gamme assez large de gyokuro, et d’autre part parce que cela laisse penser que ce serait un thé de qualité supérieure par rapport au sencha. Or, cela est tout à fait faux. Il s’agit d’un type de thé, et surtout d’un mode de consommation très différents, si bien que sencha et gyokuro ne doivent pas être mis en comparaison sur des critères de gamme.
Ce qui fait la particularité du gyokuro est d’être un thé issu de plantations en culture ombrée. Les théiers sont ombrés au minimum 20 jours avant le jour prévu de la récolte, parfois plus d’une quarantaine de jours. En revanche, la méthode de fabrication après la récolte n’est guère différente de celle du sencha.
Il faut néanmoins aussi comprendre qu’il existe plusieurs méthodes d’ombrage et de récoltes qui influent d’une manière conséquente la qualité du produit fini.
● Plantation de type shizen-shitate, ombrage sous tonnelle, récolte manuelle
C’est la méthode originelle, la plus authentique et haut de gamme aussi.
Les théiers ne sont pas taillés comme une plantation standard. Ainsi cela contraint à une récolte manuelle. Aussi, après la récolte, les théiers sont coupés très bas, et on les laisse repousser pendant un an. C’est pourquoi une seule récolte par an n’est possible. Ce type de plantation est ombré sous une tonnelle (tanashita), c’est à dire sous une structure permettant de circuler sous la couverture. La couverture peut-être en fibre naturelle (store de roseau, et paille) ou bien synthétique (la couverture peut être alors simple, double, ou triple, permettant de réguler la force de l’ombrage).
● Plantation standard
Dans le cas d’une plantation taillée standard, plusieurs cas de figure sont possibles.
・Récolte manuelle / ombrage sous tonnelle
・Récolte mécanique / ombrage sous tonnelle
・Récolte mécanique / ombrage direct (c’est à dire que les théiers sous directement recouverts d’une couverture en fibre synthétique qui ne permet pas de circuler en dessous, comme c’est le cas d’un certain nombre de sencha)
Pourquoi ombrer les théiers?
Cela sert à produire des feuilles de thé très riches en umami.
Le théier tire du sol par les racines les composés azotiques qui formeront les acides aminés responsables de l’umami. Ces acides aminés se transforment dans feuilles en polyphénols astringents sous l’effet de la photosynthèse. L’ombrage permet de ralentir ce processus et donc de conserver plus d’umami.
Par ailleurs, l’ombrage ralenti aussi la décomposition de la caféine, rendant ainsi les thés ombrés plus riches en cette substance.
C’est pour mettre en avant cet umami très puissant des gyokuro que l’on prépare ceux-ci de manière très dense, avec beaucoup de feuilles et très peu d’eau, en faisant une infusion très tiède pour limiter la diffusion des polyphénols astringents. C’est une sorte d’espresso du thé japonais.
Le gyokuro est traditionnellement produit à Kyôto (thé de Uji) mais le département de Fukuoka avec son gyokuro de Yame est devenu le leader, avec un style un peu différent. Plus modeste on trouve aussi le gyokuro de Asahina à Shizuoka.
Le tencha / matcha
Le thé produit, sorte de matériau brut, est appelé tencha. C’est une fois moulu qu’il prend le nom de matcha.
Bien que ce type de thé ne soit guère consommé au quotidien au Japon, il n’en reste pas moins que c’est le seul type de thé japonais dont la production ait, depuis les années 90, connu une progression importante. Néanmoins il faut comprendre que cette progression est le fait d’une production moyenne ou bas de gamme destinée à la pâtisserie ou aux boissons lactées.
En effet, fondamentalement le matcha authentique est issu de plantations shizen-shitate (voir l’explication plus haut dans le paragraphe sur le gyokuro), sécher en four tencha-ro, non roulé, et moulu à l’aide de meules en pierre. S’il n’existe pas de statistique précise, on estime que ce type de matcha ne représenterait que 3% du thé vendu en tant que matcha japonais dans le monde.
Il existe ensuite pour les méthodes de récoltes toutes les variations que l’on a vu pour le gyokuro, avec en plus des tencha produits avec des deuxièmes récoltes, ou même pire avec des récoltes d’automne pas même ombrées appelés akiten.
Les matcha les plus bas de gammes ne sont pas moulus avec des meules en pierre mais avec des meules à billes céramiques qui donnent un grain moins fin.
La particularité de la fabrication du tencha est qu’après l’étuvage, les feuilles sont séchées dans une sorte de grand four en brique (tencha-ro) sans être malaxées ou roulées. Il existe aussi des fours plus simples (kan.i-ro) utilisés pour les produits bas de gamme.
Il n’existe pas pour le matcha de grades définis, ainsi au Japon, le « grade cérémoniel » n’existe pas, c’est une invention de certains vendeurs occidentaux. Demandez-donc à votre vendeur le type de plantation, de récolte, d’ombrage, etc du matcha qu’il vous propose.
Enfin, pour le matcha comme pour le gyokuro, le concept de thé nouveau ou shincha, n’est pas utilisé, car on considère que ces thés ont besoin de maturation avant de pouvoir être dégustés. Les thés de l’année sont généralement mis en vente à partir de l’automne. Le matcha est conservé sous forme non moulue de tencha. A Uji, certains considèrent même qu’un an de maturation est nécessaire.
Le matcha aurait été introduit de Chine en 1191 par le moine Eisai. A cette époque, les plantations n’étaient pas ombrées. Cette habitude aurait commencé au 16ème.
Le tencha est traditionnellement produit à Kyôto (thé de Uji) mais le département de Aichi avec Nishio est devenu une zone de production très importante surtout centrée sur le matcha industriel.
Kabuse-cha
Le kabuse-cha, comme son nom l’indique en japonais, est un thé vert « couvert », c’est à dire ombré. Il s’agira le plus souvent d’un ombrage direct. La durée d’ombrage est moins longue que celle d’un gyokuro, mais plus longue que celle de la plupart des sencha ombrés, soit 2 semaines environ. On les trouve essentiellement à Kyôto et à Mie.
La méthode de manufacture est la même que pour le sencha.
Le Tamaryokucha (étuvé)
Bien que le tamaryokucha soit un nom relativement connu parmi les amateurs de thé en occident, c’est en réalité un genre de thé tout à fait mineur au Japon.
Parfois appelé guricha, tamaryokucha désigne le plus souvent le mushisei-tamaryokucha, un thé vert étuvé, par opposition au kamairi-sei tamaryokucha présenté dans la section suivante, qui n’est pas étuvé mais torréfié par contact comme les thés verts chinois. S’il s’agit d’un thé vert étuvé comme les thés évoqués précédemment, la méthode de malaxage et de séchage est légèrement différente de celle du sencha. La dernière phase de malaxage n’est pas effectuée, ainsi les feuilles n’ont pas la forme caractéristique d’aiguille du sencha. Pour pallier à cette phase, deux phases de séchage sans malaxage sont ajoutées.
Cette méthode de fabrication fut mise au point dans les années 1920 dans le but d’obtenir un thé dont l’aspect ressemble à celui du kama-iri cha, c’est un dire des thés verts chinois, tout en utilisant les infrastructures en place destinées au thé étuvé. Il fallait en effet à cette époque un thé qui, pour l’exportation vers le Moyen-Orient via l’Union Soviétique, puisse être mélangé à du thé vert chinois.
Il est aujourd’hui essentiellement produit à Kyûshû dans les départements de Saga à Ureshino, de Nagasaki à Sonogi et de Kumamoto.
Il est aujourd’hui souvent produit avec un étuvage de type fukamushi, et en culture ombrée.
De plus sa méthode de fabrication donnant plus d’importance à l’effet de la chaleur lui confère souvent des parfums plus chaleureux et sucrés qui, ajoutés à l’umami de l’ombrage, en fait un thé très facile d’accès.
Le kama-iri cha
Ce dernier type de thé vert est plus ancien que le sencha, la méthode d’arrêt de l’oxydation des feuilles fraiches par chauffage sur une surface chaude puis de séchage par malaxage ayant été introduite de Chine au 17ème siècle. Aujourd’hui cette méthode est ultra minoritaire, ayant largement été remplacée par l’étuvage au 19ème siècle.
Sa dénomination officielle est kamairi-sei tamaryokucha, en raison de la forme des feuilles sèches, proche de celle du tamaryokucha étuvé.
Il est produit essentiellement à Kyûshû, dans les départements de Miyazaki et de Kumamoto. C’est un type de thé peu astringent, très parfumé avec des accents empyreumatiques prononcés. Très peu connu même au Japon, c’est pourtant un type de thé intéressant et facile d’accès.
Thés noirs et thés Oolong
Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Japon produit du thé noir depuis la deuxième moitié du 19ème siècle. Alors que l’industrie du thé se développait à grands pas avec les exportations vers l’occident du sencha, le gouvernement décida de développer aussi pour les marchés étrangers une production de thé noir. Malgré tous les efforts déployés, cette entreprise ne fut jamais couronnée de succès et la production de thé noir disparut presque complément au début des années 1970.
Cette production de thé noir a repris petit à petit dans les années 1980 avec une poignée de producteurs passionnés, et a connu un vrai gain d’intérêt, et surtout une hausse importante de la qualité depuis les années 2010. Bien que cette production reste anecdotique au regard de la totalité de la production de thé au Japon, elle devient de plus en plus intéressante, et nous nous efforçons à Thés du Japon d’en présenter le meilleur.
De l’époque où le gouvernement soutenait le développement du thé noir, il nous est resté un certain nombre de cultivars à thé noir comme Benihomare pour le plus ancien, sélectionné à partir de graines de théiers indiens rapportées au Japon par Tada Motokichi en 1878, ou Benihikari, Benifûki pour les plus récents et répandus. Néanmoins, on trouve aussi des thés noirs formidables réalisés avec des cultivars à thé vert, comme Izumi, Kôshun, etc.
Aujourd’hui le thé noir japonais est parfois évoqué sous le nom de wa-kôcha (« thé noir japonais » littéralement) ou ji-kôcha (« thé noir local »).
Rappelons enfin que le thé noir est fabriqué à partir des mêmes feuilles que le thé vert, mais avec un processus différent. Les feuilles sont « fermentées » selon la nomenclature officielle, mais il ne s’agit en réalité pas d’un phénomène de fermentation mais d’oxydation. Après la cueillette les feuilles sont flétries, puis malaxées avant qu’on les laisse s’oxyder. Enfin elles sont chauffées pour stopper l’oxydation et pour les sécher (il peut y avoir ensuite d’autres phases de torréfaction)
Il existe aussi une production de thé oolong, plus confidentielle encore, pour laquelle plus de progrès encore restent à faire.
Les bancha
J’écris « les » et non pas « le » bancha car ce vocable désigne plusieurs réalités différentes. D’abord, il y a l’utilisation la plus commune de ce mot pour désigner des sencha grossiers issus de récoltes tardives. Il peut s’agir de récoltes d’automne (shûtô-bancha) aussi bien que de feuilles tardives et épaisses récoltées après la première récolte (on parle parfois de kari-ban).
Mais ce terme désigne aussi parfois toute une variété de thés régionaux traditionnels, aux méthodes de fabrication très diverses (feuilles simplement bouillies et séchées au soleil, feuilles fermentées, etc). Devenus très rares il s’agissait de produits populaires du quotidien très liés au repas. Jusqu’à l’après-guerre c’était ce type de thé, et non pas du sencha et encore moins du matcha que consommait le japonais moyen. On peut citer les kyô-bancha, mimasaka bancha, goishicha, etc.
Autres types de thés
Les thés présentés ci-dessous ne sont pas des genres au même titre que ceux présentés plus haut car ils proviennent d’une transformation à partir de ces thés précédemment évoqués.
● Hôji-cha
Produit de la torréfaction à haute température d’un thé vert généralement bas de gamme.
● Genmaicha
Ajout de riz grillé à un thé vert, généralement un sencha bas de gamme ou un bancha.
● Kuki-cha
Kuki désigne les tiges de théier qui sont triées lors de la phase de raffinage d’un sencha ou autre. Ces tiges peuvent alors être vendues en tant que kuki-cha ou bien être utilisées comme matière première pour faire du hôji-cha.
Le kuki-cha est ce qu’on appelle un « demono ».
● Kona-cha
Autre demono, il s’agit là de la poudre triée lors du raffinage du thé brut aracha.
● Me-cha
Autre demono, il s’agit là de petits fragments de bourgeons triés lors du raffinage du thé brut aracha.
● Funmatsu-cha
Ce terme désigne un thé vert réduit en poudre, mais il ne s’agit pas pour autant de matcha. Le matériau brut est alors un thé très bas de gamme et les méthodes de pulvérisation sont aussi différentes (freeze dry, etc). C’est en général ce que l’on trouve en tant que thé vert instantané, qui a remplacé par exemple le kona-cha dans la plupart des restaurants de sushi.